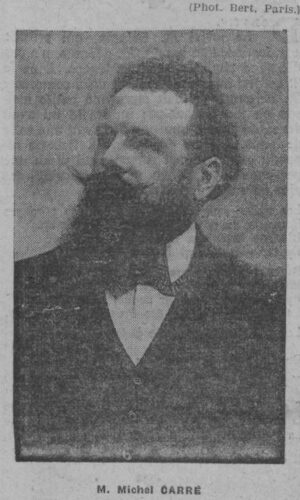Dans la longue et fascinante vie de Michel Carré (Paris, 7 février 1865-11 août 1945) c’est toute l’histoire du cinéma muet que l’on peut lire en filigrane.
Débuts et carrière théâtrale
Carré naît dans une famille à profonde tradition scénique et théâtrale. Son père, et son homonyme (raison pour laquelle on retrouve souvent le nom du cinéaste accompagné de l’épithète « fils »), qui décède en 1872 alors qu’il n’a que sept ans, est un auteur de théâtre reconnu et un librettiste prolifique pour l’opéra. Son cousin, Albert Carré (1852-1938), est comédien, dramaturge et metteur en scène, ainsi qu’administrateur ou directeur de plusieurs théâtres célèbres de Paris (Opéra-Comique, Comédie-Française…) – une célébrité à l’époque, et un animateur de la vie mondaine de la capitale.
Ce milieu familial aisé, cultivé et stimulant, l’incite à se lancer, lui aussi, dans la carrière théâtrale. À la différence de ses prédécesseurs, Michel Carré fils révèle tout de suite une préférence et une prédisposition pour les formes de spectacle plus légères sinon populaires, en se tournant principalement vers une production de comédies, chansons, piécettes pour cafés-concerts ou variétés, vaudevilles, féeries lyriques, saynètes, revues, opérettes.
Il joue surtout un rôle central dans la renaissance et la rénovation de la pantomime : en effet, il est l’un des fondateurs du Cercle des Funambules en 1888, dont il fut le président entre 1893 et 1897. Ce cercle propose une nouvelle conception du genre contre les conventions anciennes et défend une expression directe de la pensée et du sentiment, affirmant le jeu du mime en tant que langage muet des luttes de la conscience et des sensations secrètes. Il vise par ce biais à son ennoblissement comme forme artistique haute[1]. Georges Wague est le plus célèbre représentant de ce mouvement rénovateur. Il est facile de reconnaître dans ce type de réflexion ce qui plus tard met Carré en phase avec la représentation cinématographique, également fondée sur l’expression muette. Cette lutte pour la légitimation d’une forme peu ou méconsidérée est un combat similaire à celui qu’il mena pour la reconnaissance du film. Sa pièce L’Enfant Prodigue, sur une musique d’André Wormser, jouée au Cercle Funambulesque et aux Bouffes-Parisiennes à partir de 1890, connaît un succès considérable et est jugée comme un des meilleurs résultats du nouveau mouvement pantomimique. Grâce à elle, Michel Carré devient un membre éminent de la Société des Auteurs et des Compositeurs Dramatiques (SACD). Mais les rapports avec cette société ne sont pas toujours idylliques, du fait du fort tempérament de Carré, prêt à se battre par tous les moyens pour s’affirmer au milieu de ses pairs et faire reconnaitre les droits dus à son art. Ainsi, en 1905, il est temporairement exclu de la Société car il refuse de retirer l’autorisation de jouer l’une de ses pièces au directeur des Bouffes-Parisiennes.
Parmi les autres réalisations remarquables de sa carrière théâtrale – qu’il poursuit parallèlement à son engagement dans le cinéma –, on peut rappeler : Rokendin (ballet-pantomime, 1892), Bouton d’Or (fantaisie lyrique, 1893), Nos bons chasseurs (vaudeville, 1894), Le Dragon vert (pantomime, 1895), Monsieur le majeur (1897), Muguette (opéra-comique, 1903), Le Clos (opéra-comique, 1906), Humaine folie (valse chantée, 1907), etc. Il revint pleinement à la scène dans les années 1920.
Rencontre avec le cinéma
La rencontre de Michel Carré avec le cinéma est pourtant traumatique. Le 21 décembre 1906 il devient l’instigateur de la première plainte pour contrefaçon d’une pièce de théâtre (et pas seulement de son titre) par le cinéma devant la Commission de la SACD. Lucien Vives, exploitant du Cinématographe-Théâtre, 7 Boulevard Poissonnière, est accusé d’avoir projeté pendant vingt-cinq jours un film qui reproduit exactement et entièrement la mise en scène du Faust de Gounod, dont Michel Carré père avait écrit le livret, avec Jules Barbier, et que Michel fils défend donc en tant qu’héritier légitime des droits d’auteur. Comme Alain Carou – auquel on doit la reconstruction de toute l’affaire – le suggère[2], il s’agissait très probablement de la vue de 260 m réalisée par Georges Méliès (n° 562-574 du catalogue de la Star Film). Cette action judiciaire découle peut-être des sentiments d’un fils pour son père dont le nom et la notoriété artistique sont piétinés. Ce devoir moral est aussi aiguillonné par la volonté de défendre les intérêts d’une catégorie professionnelle, menacée par le succès croissant du nouveau spectacle qu’est le cinéma qui, par ailleurs, s’approprie ses lieux de prédilection : les boulevards.
Cette expérience marque profondément l’esprit de Michel Carré-homme de théâtre, et forge chez lui la conviction qu’il vaut mieux collaborer, travailler avec et dans le cinéma, que s’y opposer à tout prix.
L’occasion de s’y essayer se présente un an plus tard, alors que Michel Carré a déjà passé la quarantaine. Son ami Edmond Benoît-Lévy, associé de Charles Pathé dans la propriété et la direction de la salle Omnia, président de la Société populaire des Beaux-Arts et défenseur acharné du spectacle cinématographique, le persuade de lui céder les droits pour une mise en images – produite à ses frais – de sa pantomime l’Enfant Prodigue. Il promet aussi de l’impliquer directement dans la réalisation du projet. L’enjeu est important : d’un point de vue économique, il faut démontrer à Pathé, réticent aux changements, et attaché à l’idée que le cinéma doit être une activité facile, un amusement immédiat, que l’adaptation des pièces du répertoire est une bonne affaire ; d’un point de vue intellectuel, il faut prouver que le nouveau médium peut être aussi un instrument de diffusion du « bon théâtre » et de la culture légitime pour le plus grand nombre ; enfin, il s’agit de mettre à l’épreuve les différentes formes d’expression et de représentation en vérifiant que projetées sur l’écran elles ont le même pouvoir émotionnel que l’action jouée au théâtre.
Michel Carré introduit donc Benoît-Lévy devant la Commission de la SACD le 17 mai 1907, pour informer les auteurs de leur volonté de traiter avec eux pour adapter leurs œuvres au cinématographe et pour les inciter à en livrer de nouvelles, spécifiquement aux fins de la reproduction cinématographique.
Le tournage de l’Enfant prodigue ne se passe pas de façon sereine. Selon le récit que Carré en dresse devant la Commission de recherche historique venue l’interviewer en 1945, Charles Pathé se révèle assez hostile à cette nouvelle conception (le film aurait même été tourné « contre sa volonté explicite »), et il ne met pas à disposition de la production – « comme il aurait pu faire » – tout ce dont celle-ci avait besoin[3]. Des photographies conservées à la BnF montrant d’un côté Michel Carré supervisant la mise en scène et le tournage, de l’autre Charles Pathé abandonnant le plateau l’air contrarié semblent attester la véracité des souvenirs tardifs de Carré.
La première du film a lieu le 20 juin 1907 au théâtre des Variétés de Paris. Du 15 juin au 15 septembre il sera projeté 123 fois, en autant de représentations – ce qui, si cela ne peut pas être qualifié d’insuccès, est cependant un succès relatif, compte tenu du fait que les Variétés est la seule salle à exploiter le film. En province, « l’Enfant prodigue n’a pas marché »[4]. Dans le même entretien de la Commission historique, Georges Sadoul avance l’hypothèse que ce semi-échec a été surtout dû à la longueur du film, à laquelle le spectateur de l’époque n’est pas habitué. Carré ajoute à cette raison, celle due à la difficulté ou la complexité de la forme pantomimique en soi, « tout de même un peu spécial[e] »[5], basée sur des conventions de représentation que le public ne saisit pas totalement.
De la SCAGL à la Première Guerre mondiale (1908-1913)
Malgré la mésentente avec Pathé et le succès relatif de son premier opus cinématographique, Michel Carré est désormais bien gagné à la cause. Quand, en 1908, l’ambitieuse et nouvelle Société Cinématographique des Auteurs et Gens de Lettres (SCAGL) lui propose de devenir l’un de ses scénaristes principaux, il accepte donc avec enthousiasme. Dès l’année suivante, il est embauché comme metteur en scène, avec un contrat qui l’oblige à fournir 400 mètres de négatif par mois (l’équivalent d’un film long ou de deux films moyens de l’époque), payés selon les positifs vendus, avec un salaire fixe mensuel de 1000 francs.
Son entrée dans l’industrie naissante du cinéma français est donc désormais officielle.
À la SCAGL, il devient vite une des figures phares, à la suite de son directeur artistique, Albert Capellani, avec qui il collabore pour nombre de productions, d’adaptations ou de réalisations. Sa renommée extra-cinématographique lui garantit une aura en tant qu’auteur, et donc le luxe et l’honneur – rares à cette époque – de voir son nom sur les affiches de ses films ou mentionné dans la presse.
Son premier travail d’adaptation pour un film à la SCAGL est Marie Stuart, mis en scène par Capellani , annoncé en septembre 1908 ; le premier film qu’il tourne comme réalisateur est Le Bal noir (sorti en mars 1909), drame de mort et de jalousie construit sur le talent de ses deux acteurs-vedettes, Henry Krauss et Jeanne Cheirel.
La figure de Capellani lui fait malgré tout un peu d’ombre. Toutefois, redéfinissant le rôle de Carré comme écrivain au sein de la SCAGL, Capellani se réserve les projets les plus prestigieux comme la transposition à l’écran des grandes œuvres de la littérature[6].
Son activité scénaristique d’adaptateur est malgré tout reconnue comme un facteur fondamental du passage de la bande primitive au film artistique, puis au long-métrage.
Outre la condensation extrême du récit, ce travail s’exerce dans l’ajout de tableaux de transition, qui permettent une continuité spatio-temporelle capable de produire sur le public l’effet d’un roman vécu. Notre Dame de Paris mis en scène en 1911 par Capellani est à cet égard exemplaire.
Comme François Amy de la Bretèque l’a bien illustré[7], le travail d’adaptation mené par Carré sur les œuvres littéraires ou les pièces que la SCAGL décide de porter à l’écran va aussi dans le sens de la recherche d’une représentation consensuelle de l’histoire, qui évite tout sujet pouvant heurter les sensibilités politiques, sociales, religieuses, culturelles : est écarté tout ce qui touche la sphère du pouvoir civil ou la représentation de classes dangereuses. Une telle « politique du consensus » s’inscrit dans la stratégie de pénétration interclassiste du marché menée par la SCAGL, de conquête d’un public le plus large possible, en accord et non en opposition avec l’idée d’une culture populaire. Voie que la SCAGL choisit en se différenciant de sa rivale directe, Le Film d’Art.
Des années passées à la SCAGL, Carré se souviendra d’avoir été très souvent « en bisbille »[8] avec Charles Pathé. Celui-ci n’aurait pas compris sa conception trop moderne du cadre filmique, son utilisation du « plan américain », et aurait ainsi imposé à Carré de revenir au plan large, théâtral, avec « la tête de l’acteur [qui] doit toucher le haut du cadre et ses pieds le bas. […] Ce n’est pas intéressant de voir les pieds »[9], aurait protesté Carré, d’après son témoignage devant la Commission historique.
Dans le même entretien transparaît son antipathie voire même son mépris à l’égard de Ferdinand Zecca. Carré le trouve trop « prétentieux » d’avoir voulu adapter Shakespeare à l’écran, se permettant, de plus, des jugements sur le dramaturge anglais, qu’en homme de théâtre il ne pouvait entendre[10]. Il s’attribue aussi le mérite d’avoir contribué au démarrage de la carrière cinématographique de Mistinguett, la célèbre vedette des scènes parisiennes qui fait sa première apparition à l’écran avec L’Empreinte ou la Main rouge (1908). Carré l’aurait présentée à Capellani pour jouer dans Fleur de pavé, en 1909.
Au total, Michel Carré travailla à une quarantaine de films pour la SCAGL, comme scénariste ou metteur en scène. Parmi ces films, il convient de citer L’Assommoir, d’après Zola, réalisé par Capellani en 1909 (film d’une longueur exceptionnelle de 760 mètres) ; les légendes moyenâgeuses telles Sœur Angélique (1909), dont il est l’auteur et le réalisateur, et la Vision de frère Benoît (d’Albert Capellani, 1911) ; La Chatte métamorphosée en femme (1910) d’après Ésope ; Athalie, en 1910, d’après la pièce de Racine et qu’il écrit et réalise probablement.
Le dernier film auquel il travaille pour la SCAGL, Le Mémorial de Sainte-Hélène, dont il écrit l’adaptation et tourne en décors naturels, près de sa propriété sur la côte normande en 1911, est tiré d’une œuvre que son père avait écrite avec Jules Barbier en 1852. Cela confère à cette production une allure d’adieu symbolique à la société qui avait accueilli l’essor de sa carrière cinématographique.
Par ailleurs, ce film se démarque aussi par son début lent, presque contemplatif. Alain Carou y voit une proximité avec les idées d’Henri Lavedan, qui justement considérait la lenteur comme l’un des moyens par lesquels le film pouvait atteindre ses possibilités artistiques en tant que forme représentative. Cependant, ce choix se révèle trop novateur pour l’époque, et le film surprend, voire déplaît, le Courrier cinématographique le jugeant même « monotone »[11].
En quittant la SCAGL en 1912, Michel Carré crée sa propre société, pour « l’édition de films cinématographiques théâtraux », la Lutetia Films[12]. Par l’intermédiaire d’Edmond Benoît-Lévy, il est approché par Joseph Menchen, un producteur américain « avec une tête d’Allemand »[13] qui l’embauche pour transposer la pantomime de Max Reinhardt[14], écrite par Karl Gustav Vollmöller, Le Miracle. Pour le tournage de ce film très ambitieux[15], tiré d’une légende déjà adaptée par Charles Nodier et Maurice Maeterlinck, Carré se rend pendant trois mois à Vienne. Il se souvient des « imperfections » de cette production et de son travail avec des opérateurs anglais qui « n’étaient pas extraordinaires »[16]. C’est tout au moins l’argument qu’il livre à Georges Sadoul pour expliquer l’absence de distribution du film en France. L’un de ces opérateurs, William Cecil Jeapes[17], évoque le tournage du film dans un entretien livré au Bioscope, publié le 19 décembre 1912. Selon lui, le tournage se passe du 21 septembre au 15 octobre 1912, tous les jours le travail s’arrêtant à 15h pour permettre à la troupe de rejoindre le théâtre de Vienne où la pièce était jouée sur scène au même moment. Le film terminé, il aurait été envoyé à Paris pour être mis en couleurs. Quand le journaliste demande à Jeapes comment il juge la transposition filmique, celui-ci est élogieux : le cinématographe et ses trucages ont permis de traiter les parties surnaturelles avec la plus grande liberté ; il peut aussi « présenter de manière réaliste et détaillée toutes sortes de situations qui ne pouvaient qu’être présentées de manière approximative au théâtre » ; enfin, il procure une impression de continuité là où la version scénique proposait une juxtaposition d’épisodes. Au cinéma, il n’est en effet pas besoin d’attendre les changements de tableaux[18].
Le film sera présenté avec un grand succès à Londres, à Covent Garden, le 21 décembre 1912 accompagné d’un orchestre dirigé par Engelbert Humperdinck, et projeté sur un écran encadré d’un décor reproduisant le porche d’une cathédrale du Moyen-Âge.
Ce film marque le début d’une période de collaboration – quoiqu’assez courte – entre Carré et Menchen. En effet, en mars 1913, Carré aide le producteur à s’installer en France, et préside à l’ouverture et à l’organisation de ses nouveaux studios à Épinay-sur-Seine, en y assumant le rôle de directeur artistique tenu à la SCAGL par Capellani. On connaît peu les activités de la société de Menchen en France. Comœdia note qu’à l’occasion des fêtes de Noël de 1913, Menchen fait paraître sur les écrans français une vingtaine de copies du Miracle, « coloriées d’après un nouveau procédé »[19]. L’année suivante, Carré travaille sur une série d’adaptations d’Arsène Lupin d’après Maurice Leblanc. Mais la société déclare bientôt faillite, et en 1914, Menchen fuit la France laissant derrière lui 30 000 francs de dettes à Carré, somme que celui-ci ne revit jamais.
Activités de guerre
Parmi les événements remarquables de l’activité de Carré pendant la guerre, il faut au moins signaler une nouvelle adaptation filmique de sa pantomime L’Enfant prodigue, en 1916, toujours à l’initiative de Benoît-Lévy. Il s’engage par ailleurs sur un nouveau projet de direction artistique avec la Phocéa Film, que Paul Barlatier crée et installe à Marseille, rêvant de faire de cette ville le « Los Angeles français ». Carré reste dans le Sud de la France quelques années et y réalise quatre films : Fleur de Provence, L’Image de l’autre, Le Retour du passé, Le Trésor des Beaumettes. Cependant, ses souvenirs sont assez imprécis sur ce sujet. Une fois encore il est déçu du peu de liberté qui lui est laissée[20]. Cette expérience marque la fin de la phase plus active de sa carrière cinématographique en tant que directeur artistique, metteur en scène et scénariste.
À la fin de la guerre, Carré a plus de cinquante ans, et une nouvelle page s’ouvre devant lui, celle de la pleine maturité : phase qui fut marquée par un engagement qu’on pourrait définir comme politique. Il se fit le chantre de la reconnaissance des professionnels du cinéma comme des auteurs.
Engagement en défense de la profession : pour la reconnaissance des professionnels du cinéma comme auteurs
Avec l’arrivée des années 1920, Carré retrouve sa première vocation théâtrale, à laquelle il continuera à se dédier avec sporadicité jusqu’aux années 1940. Son dernier accomplissement dans ce sens-là est le texte pour l’opérette La Tendre Alyne de 1941.
Mais surtout, il commence à travailler en arrière-plan pour conférer aux scénaristes et aux metteurs en scène de films le même statut juridique que celui des auteurs dramatiques. Cela, encore une fois comme souvent dans sa vie, commence presque par hasard. Camille de Morlhon, qui avait fondé en 1917 la Société des auteurs des films (SAF) dans le but d’obtenir l’instauration du droit d’auteur dans sa double dimension morale et patrimoniale, en quitte la présidence le 27 janvier 1922. Début février, Henri Pouctal est nommé comme son successeur, mais pas pour longtemps : cinq jours plus tard celui-ci est en effet frappé par une congestion cérébrale, et meurt. C’est ainsi que Michel Carré se retrouve à la tête de la Société, qui sous son impulsion vire résolument vers une stratégie de rapprochement avec la SACD.
Cependant, la lutte qu’il entreprend pour la défense de la profession ne se construit pas seulement par un biais institutionnel ou officiel, mais aussi à travers l’adhésion et le soutien aux groupes et cercles cinéphiles qui explosent à la même époque à Paris, participant donc activement à la naissance d’un « réseau du cinéma alternatif », pour reprendre une expression de Richard Abel. Il compte parmi les fondateurs du Club français du cinéma (CFC) – pour son caractère essentiellement professionnel et corporatif, il s’agit plus d’un syndicat ou d’un groupe de pression qu’un véritable club, comme le rappelle Christophe Gauthier[21] – qui donne un appui explicite et important à la première avant-garde ; il préside également la Fédération française des artistes, fondée en 1922, au sein de laquelle il contribue à la constitution de la section cinéma.
Avec les groupes indépendants ou d’avant-garde, il vivra aussi des moments de tension et de véritables divergences. Par exemple, à l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, la SAF expose à son instigation un théâtre de prises de vues en taille réelle, avec la prétention « de faire voir au public en raccourci ce qu’est un studio en plein travail, pendant une scène de prise de vue »[22]. Cette approche purement technique fait polémique parmi les partisans d’une conception absolue du cinéma comme art, et Moussinac déplore la participation de la SAF comme une occasion manquée, à intérêt purement pittoresque[23].
Les années de Carré à la présidence de la SAF seront rappelées surtout pour les négociations intenses qui ont mené à l’intégration avec la SACD et qui, entre 1923-1924, aboutissent à l’acceptation par les auteurs et les compositeurs d’un quota d’un cinquième d’« auteurs cinégraphistes » comme sociétaires. C’est dans le sillage de ces combats si, à l’arrivée du parlant en 1929, la SACD acceptera finalement l’entrée massive de tous les auteurs de films, décrétant ainsi la fin d’une hégémonie – celle des arts scéniques, puis du textuel sur le filmique proprement dit – datant de plus de vingt ans.
Mais à ce moment-là, Carré n’était plus président de la SAF. Suite à un « non-accord » sur une décision à prendre, devenu bientôt un « désaccord »[24], Carré se résigne à sa démission en juillet 1925. Le 30 octobre de la même année, Charles Burguet est nommé nouveau président. Mais « un général … reste soldat quand même », comme écrit Jean-Louis Croze dans Comœdia, « efficace est son concours, précieux son conseil ».
Du haut de ses soixante ans, il profitera de sa consécration définitive, la réception de la croix de chevalier de la Légion d’honneur en 1927 ; et pendant les dernières vingt années de sa vie, continuera à suivre, mais sous une forme plus silencieuse et à distance, les vicissitudes du cinéma et du théâtre, les arts auxquels il avait consacré son entière existence.
Il meurt à Paris le 11 août 1945, peu de mois après la visite que la Commission de recherche historique lui avait rendue pour recueillir ses souvenirs et son témoignage.
Bibliographie
Sources primaires :
- Benoît-Lévy, Edmond, « L’Enfant prodigue », Comœdia, 2 jullet 1926, p. 3.
- « Carré (Michel) », dans Charles-Emmanuel Curinier (dir.), Dictionnaire national des contemporains, t. 2, 1899, p. 8.
- Commission de recherche historique, « Michel Carré : réunion du 12 février 1945 », Cinémathèque française, CRH19- B1 : http://www.cineressources.net/consultationPdf/web/a000/036.pdf
Références :
- Amy de la Bretèque, François, « Représentations du Moyen Âge dans les séries d’art françaises », Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 56, 2008, pp. 288-303 : http://journals.openedition.org/1895/4080.
- Azoury, Philippe, Les Miroirs de la dispersion : la SCAGL, exemple pour une archéologie du vocable « film d’art », mémoire de DEA, sous la direction de Michel Marie, Université de Paris 3, 1995.
- Carou, Alain, Le cinéma français et les écrivains, histoire d’une rencontre 1906-1914, Paris, École nationale des chartes/AFRHC, 2002.
- Gauthier, Christophe, La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, Paris, AFRHC/École nationale des chartes, 1999 (en part. pp. 62-65, 130-133).
- Gili, Jean A., Le Roy, Éric (dir.), « Albert Capellani, de Vincennes à Fort Lee », 1895, n° 68, 2012.
- Le Forestier, Laurent, « Michel Carré », dans Richard Abel (dir.), Encyclopedia of Early Cinema, London, Routledge, 2005, p. 105.
- Loyant, Xavier, La Société des auteurs de films (1917-1929), thèse sous la direction de Jean Gili, École nationale des chartes, 2009 : http://theses.enc.sorbonne.fr/2009/loyant.
- Meusy, Jean-Jacques, « Aux origines de la Société cinématographiques des auteurs et gens de lettres (SCAGL) : le bluff de Pierre Decourcelle et Eugène Gugenheim », 1895, n° 19, 1995, pp. 6-17.
- Rykner, Arnaud, « Pantomime, pré-cinéma et cinéma : transferts, pulsions, modèles », dans Marguerite Chabrol, Tiphaine Karsenti (dir.), Théâtre et cinéma. Le Croisement des imaginaires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, pp. 37-54.
- Serceau, Michel, Y a-t-il un cinéma d’auteur ?, Chapitre I : « Les concepts d’ “auteur” et de “cinéma d’auteur” : historiographie d’une question et de sa réception », Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014, pp. 27-92.
- Sirois-Trahan, Jean-Pierre, « SCAGL », dans Richard Abel (dir.), Encyclopedia of Early Cinema, London, Routledge, 2005, p. 815.
- https://www.artlyriquefr.fr/personnages/Carre%20Michel%20fils.html


 Retour aux éditorialisations
Retour aux éditorialisations