Le Service de Santé en France.
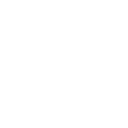
| Country |
Country France |
|---|---|
| Production year |
Production year 1916 |
| Length (meters) |
Length (meters) 1153,2 m |
| Length (time) |
Length (time) 0:59:58 |
| Genre |
Genre Documentaire |
| Credits |
Credits Chaix, Louis (Opérateur) ; Stuckert, Henri (Opérateur) |
| Summary |
Summary Première partie.??(Cette partie est une reprise de la référence SS1, images de 1916, augmentée de quelques séquences supplémentaires : hôpital d'Etapes et opérations chirurgicales)??A travers diverses séquences, on observe l'organisation et le fonctionnement du Service de Santé, depuis le ramassage du blessé jusqu'à sa guérison, montrant par là le personnel médical à l'oeuvre, le matériel de transport utilisé, les structures d'accueil et de soins.??Tout d'abord, nombre de médecins auxiliaires ou majors, portant un brassard, montent en ligne, avec à la fin du convoi des brouettes porte-brancards et des véhicules sanitaires hippomobiles, ainsi qu'un médecin principal et un aumônier.?Sur le front, dans les tranchées, des brancardiers évacuent les blessés sur des brancards ou des brouettes porte-brancards, tandis que les blessés capables de marcher les suivent, s'appuyant sur des cannes bien souvent et portant des bandages. Ils les conduisent vers des postes de secours, simples baraquements ou abris, signalés d'une croix.?Là, les blessés, pansés et portant leur fiche médicale, attendent leur évacuation vers les hôpitaux, qui s'effectue à bord d'un véhicule sanitaire.?A "l'Ambulance", Hôpital d'Origine d'étapes (1), un "médecin major procède au premier examen de triage". Dans une salle de blessés alités, il lit la feuille de soins de deux d'entre eux.?Puis, dans l'hôpital choisi selon la gravité du blessé, infirmiers et médecins apportent les soins nécessaires aux soldats alités. Ils effectuent également des interventions chirurgicales. ?Enfin, les derniers plans présentent un blessé guéri, souriant à la caméra et montrant avec fierté la balle qu'il devait avoir reçue.??Deuxième partie (TC 00:17:38).??Une deuxième partie présente plus particulièrement "les différents modes d'évacuation".?Tout d'abord, le blessé peut être transporté en automobile sanitaire, sorte de camionnette, où il est embarqué assis ou couché sur un brancard.?Autre possibilité : le train sanitaire. Train spécial, où des brancardiers et infirmières chargent et déchargent les blessés, et leur distribuent à manger lors des arrêts en gare (TC 00:21:45 : gare de Chateau-Thierry ; blessés portés à dos d'homme et automobile sanitaire venant de garer en marche arrière près du train ; 1916, opérateur inconnu) (2).?C'est également à dos de mulet, sur cacolets que sont transportés les blessés. Ils peuvent aussi être charriés à la place d'un side-car de moto.?Lorsque les postes de secours sont installés au bord d'une rivière, les blessés sont évacués par canots (images d'Henri Stuckert, compte-rendu n° 1032, le 03/12/1917 à Pontavert).?Le transport en automobile sanitaire reste le plus courant. Nombre de blessés sont embarqués ou débarqués pour être conduits au poste de secours ou pour en repartir (pour être évacués vers les hôpitaux). Un véritable trafic de véhicules sanitaires s'opère sur le front. Il existe un nombre important d'entrepôts de véhicules et d'ambulanciers.??Troisième partie (TC 00:33:52) (2).??Dans une troisième partie, on présente les établissements de soins.?"De nombreux châteaux ont été transformés en hôpitaux", tels les châteaux de Verneuil, de Pargny-les-Reims, de Boursault, de Pierrefond, de Virly (commune de Jouaignes), de Vivières, de Coeuvres et de Galliéra, dont on observe les façades, les salles de blessés et les jardins où des convalescents se promènent.?Des usines aussi servent d'ambulance, telle celle de Brunsvick, où l'on voit les baraques réquisitionnées et où les malades sont installés dans les grandes salles.?Un groupe de soldats patiente devant la voiture stomatologique du lieutenant Gaumerais, médecin major, qui prodigue des soins dentaires à un patient dans le véhicule spécialement aménagé.?eDans un hôpital militaire de l'arrière, installé dans une grande demeure, des blessés sont débarqués d'un véhicule sanitaire et conduits dans une grande salle où des infirmiers s'occupent d'eux. Dans le jardin d'un château qui sert d'hôpital, les convalescents prennent le soleil, tandis que le personnel sanitaire les entoure. Parmi celui-ci, deux infirmières dévouées de la Croix-Rouge portent la croix de guerre.??Quatrième partie (TC 00:45:32).??Une quatrième partie est consacrée à la rééducation des mutilés et à leur retour au travail.?Dans le parc d'un hôpital, plusieurs soldats effectuent des exercices d'assouplissement et de marche. Pour les mutilés aussi, des membres artificiels ont été fabriqués. Une longue séquence présente un avant-bras artificiel, actionné par un civil et essayé par un mutilé.?"L'union des Colonies Etrangères en France" (images de l'opérateur Lauward ; comptes rendus n° 1219, 1223 et 1232 les 15 et 16/03/1918 à Paris et Juvisy) se charge d'apprendre un métier à ces hommes malgré leur mutilation. Ainsi, les mutilés exercent devant des moniteurs divers travaux d'artisanat, tels que la bourrellerie, la menuiserie, la ferblanterie, la cordonnerie, la ferronnerie, la vannerie. Ils effectuent également du jardinage et des travaux des champs comme le passage de la herse, le fumage, la garde du bétail, le fauchage, la moisson, les semailles, le labourage, ..., à l'aide de machines agricoles qu'ils peuvent actionner avec leurs membres artificiels.?Le film s'achève sur la vision d'un "glorieux mutilé", le général Gouraud, qui décore une femme en deuil et une ambulancière, puis partage un pot avec le groupe d'officiers présents. |
| Comments |
Comments Film en quatre parties.?Première partie : 278,4 m. 1+11 cartons en français.?Deuxième partie : 315,4 m. 1+7 cartons en français.?Troisième partie : 219 m. 1+ 17 cartons en français.?Quatrième partie : 340,4 m. 1+12 cartons en français.??(1) Hôpital origine d’étapes : terme ancien désignant un hôpital d’évacuation. Voir origine de l’expression sur :?http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/hoe-1914-h%C3%B4pital-d%E2%80%99%C3%A9vacuation-ou-h%C3%B4pital-d%E2%80%99origine-d%E2%80%99%C3%A9tapes??(2) Les séquences constituant la 3e partie ainsi que celle filmée dans la gare de Chateau-Thierry datent d’avant novembre 1916. Voir les précisions sur la datation dans la note du film 14.18 A 875. |
| Source |
Source ECPAD |
| Lien vers la source |
Lien vers la source https://imagesdefense.gouv.fr/fr/le-service-de-sante-en-france.html |
| Reference/Identifier |
Reference/Identifier 14.18 A 850 |
https://imagesdefense.gouv.fr/fr/le-service-de-sante-en-france.html


 Go back to resources
Go back to resources